
Le Cerema Ile-de-France a organisé, à destination des collectivités, des bureaux d’études et des services de l’Etat, une journée technique sur la renaturation des sols à l’échelle du projet le 1er avril 2025. Ce sont près de 100 personnes, dont plus de la moitié venant de collectivités territoriales, qui ont répondu présentes à l’Académie du Climat, en plein cœur de Paris.
Cette journée s’inscrit dans la continuité des travaux engagés par le Cerema depuis plusieurs années, notamment lors de la journée de 2019 consacrée aux solutions pour la ville de demain. Depuis, le sujet de la renaturation des sols a gagné en visibilité et en importance au regard de nombreux enjeux, dont ceux d’adaptation au changement climatique et d’érosion de la biodiversité.
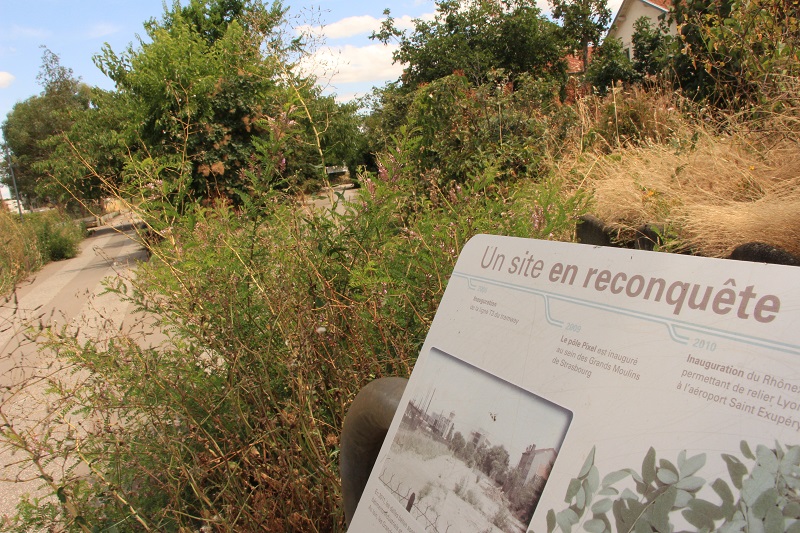 La question de la prise en compte des sols, de leur état, leurs fonctionnalités est centrale pour les projets de renaturation car le sol constitue une brique essentielle des écosystèmes terrestres, socle vivant dont dépend la résilience des territoires. Pourtant, cette prise en compte reste encore trop marginale dans les projets d’aménagement ou les démarches de renaturation dites "classiques", souvent centrées sur le végétal en surface et rarement sur ce qui se passe en dessous. La renaturation ne se limite pas à compenser l’artificialisation ou verdir les villes, elle suppose une logique d’ensemble, une stratégie territoriale pensée en amont, des diagnostics pour connaitre les milieux et les écosystèmes ainsi que des expertises croisées.
La question de la prise en compte des sols, de leur état, leurs fonctionnalités est centrale pour les projets de renaturation car le sol constitue une brique essentielle des écosystèmes terrestres, socle vivant dont dépend la résilience des territoires. Pourtant, cette prise en compte reste encore trop marginale dans les projets d’aménagement ou les démarches de renaturation dites "classiques", souvent centrées sur le végétal en surface et rarement sur ce qui se passe en dessous. La renaturation ne se limite pas à compenser l’artificialisation ou verdir les villes, elle suppose une logique d’ensemble, une stratégie territoriale pensée en amont, des diagnostics pour connaitre les milieux et les écosystèmes ainsi que des expertises croisées.
La journée s’est ainsi articulée autour de 4 grandes séquences :
- Une première séquence sur les définitions en lien avec la renaturation des sols et du cadre juridique et des politiques publiques qui portent la renaturation des sols.
- Une deuxième séquence sur les outils afin de construire des stratégies de renaturation à l’échelle des territoires puis des projets.
- Une troisième séquence, objet principal de la journée, sur la mise en œuvre de la renaturation des sols à l’échelle du projet à travers 4 étapes principales : Par quoi débuter ? Avec quelle connaissance ? Comment passer à l’action ? Comment pérenniser ces aménagements ? L’ensemble de cette séquence a été abordé à travers la présentation de divers retours d’expériences portés par des collectivités, bureaux d’études, et chercheurs.
- Enfin, une table ronde a permis de compléter les interventions précédentes et de faire dialoguer les participants (intervenants et auditoire) à la journée.
La renaturation des sols : quels enjeux ?
Cette première séquence a permis à Philippe Branchu (Cerema) de poser les bases de définitions autour de la renaturation des sols et d’insister sur le fait que la renaturation des sols porte une vision pédo-centrée qui a pour objectif d’améliorer tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol : hydrique, climatique, biologique et potentiel agronomique. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de la restauration écologique qui présente une vision éco-centrée avec comme objectif principal le rétablissement de tous les attributs d’un écosystème de référence.
Cette présentation s’appuie en partie sur les sorties du projet Indiquasol qui vise à établir un référentiel d'indicateurs pour évaluer la qualité et la santé des sols en France. Issu d’une saisine de différents organismes dont les ministères en charge de l’Environnement et de l’Agriculture et coordonné par l’INRAE, ce projet fournit des outils pour soutenir les politiques publiques de préservation et de renaturation des sols et est disponible à l'adresse suivante :
Constance Berté et Yann Lancien (Ministère en charge de l’Environnement/Direction de l’Habitat de l’Urbanisme et des Paysages) ont ensuite rappelé comment la renaturation des sols s’intègre, à l’échelle nationale, dans le cadre de la loi Climat et résilience de 2021 et l’objectif du Zéro Artificialisation Nette ainsi que la définition retenue de la renaturation dans le code de l’urbanisme. A l’échelle européenne, la mise en œuvre du règlement de la restauration de la nature fait écho à la renaturation des sols, notamment dans son article 8 sur les écosystèmes urbains. De plus, le projet de directive sur la surveillance et la résilience des sols fixe un objectif de parvenir à des sols en bonne santé d’ici 2050. Enfin, le ministère a présenté les différents leviers mobilisables pour la renaturation et en particulier le fonds vert dont la mesure sur la renaturation est pérennisée en 2025.
 Suite aux questions du public, des précisions ont été apportées quant à la différence entre anthroposols et technosols : ce sont des termes issus de 2 référentiels pédologiques différents, national pour le premier et international pour le deuxième. Les technosols sont associés à la présence d’un niveau "technique" induré en surface et la présence d’artéfacts (objets d’origine humaine, comme des fragments de céramique ou de briques). On sépare les anthroposols construits et reconstitués des technosols du fait que les premiers sont liés à une action volontaire de construction d’un sol.
Suite aux questions du public, des précisions ont été apportées quant à la différence entre anthroposols et technosols : ce sont des termes issus de 2 référentiels pédologiques différents, national pour le premier et international pour le deuxième. Les technosols sont associés à la présence d’un niveau "technique" induré en surface et la présence d’artéfacts (objets d’origine humaine, comme des fragments de céramique ou de briques). On sépare les anthroposols construits et reconstitués des technosols du fait que les premiers sont liés à une action volontaire de construction d’un sol.
La définition de la santé des sols est à venir dans le texte final de la directive cadre sur les sols avec une définition d’indicateurs plutôt sur les menaces que sur les fonctions (le projet Indiquasol présente lui des indicateurs sur les menaces et de fonctions).
Outils stratégiques et opérationnels

La deuxième séquence a permis de présenter les ressources (outils, guides, méthodologies…) existantes aujourd’hui (non exhaustives) sur la renaturation des sols. Tout d’abord à l’échelle de la planification, Christelle Neaud (Cerema) a présenté une méthode d’identification du potentiel de renaturation qui permet d’identifier les espaces à renaturer en priorité en fonction de 3 volets :
- un volet "qualité des sols" qui s’appuie principalement sur l’occupation des sols et la hauteur de végétation,
- un volet "enjeux" qui recense les espaces où les enjeux se superposent (Ilot de chaleur urbain, inondation, érosion de la biodiversité, carence en espaces verts, érosion des espaces agricoles)
- un volet "mutabilité des espaces" qui prend en compte la dureté foncière (niveau de difficulté à mobiliser ou acquérir un terrain) et la présence potentielle de friches.
Le croisement de ces 3 volets renseigne sur les espaces où la renaturation serait potentiellement intéressante.
A l’échelle du projet, Zoé Raimbault (Institut de la Transition Foncière) a présenté un projet de référentiel technique pour la renaturation des sols. Cet outil en construction vise à faire le lien entre porteurs de projets et acteurs scientifiques et techniques intervenant sur les projets (notamment les bureaux d’études) afin de faciliter la rédaction des cahiers des charges par les porteurs de projet. Ce référentiel est construit comme un outil d’aide à la conception d’une opération de renaturation et d’aide au choix des techniques appropriées, en fonction de l’état initial (contexte du site, état des sols) et de l’état final (usage projeté), tout en restant adaptable à la diversité des contextes territoriaux. Ce premier tri des espaces est un potentiel qui nécessite de confirmer son opérationnalité sur le terrain par bien d’autres critères.
Suite aux questions du public, il a été précisé que pour la méthode d’identification du potentiel de renaturation, les résultats ont été obtenus selon des mailles de 200x200m et 100x100m liées à la précision des données en entrée, ne permettant pas de localiser finement les parcelles à renaturer (stratégie globale de potentiel de renaturation à l’échelle du territoire). Il existe une complémentarité entre stratégie globale de renaturation sur l’ensemble du territoire et renaturation par opportunité, au cas par cas.
Renaturation à l'échelle opérationnelle
La 3ème séquence sur la renaturation à l’échelle opérationnelle s’est ouverte par la présentation d’Aurélien Huguet (AH Écologie) et Quentin Vincent (EODD) qui sont revenus sur l’importance de croiser les compétences en écologie et en pédologie dans un projet de renaturation des sols. Ils ont illustré leur propos avec quatre cas d’étude de renaturation, à différentes échelles :
- l’atelier des territoires de la Communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, dont l’objectif était la réalisation de diagnostics généraux pour orienter ensuite le projet de renaturation,
- la ZAC des côteaux d’Ormesson (94) afin d’assurer les continuités écologiques dans un projet de renaturation,
- la Végétale dont l’objectif était de partir des sols existants pour fixer le projet de renaturation
- la toiture végétalisée à Montmartre afin de recréer un "sol" en s’inspirant d’un site naturel.
L'intervention a également mis en lumière l’importance du suivi écologique et la possibilité de réajuster les projets en fonction des résultats de suivi.
 Cette séquence s’est poursuivie l’après-midi avec une intervention conjointe de Pierre-Alain Maron (INRAE) et Quentin Vincent (EODD), centrée sur les diagnostics nécessaires à un projet de renaturation des sols.
Cette séquence s’est poursuivie l’après-midi avec une intervention conjointe de Pierre-Alain Maron (INRAE) et Quentin Vincent (EODD), centrée sur les diagnostics nécessaires à un projet de renaturation des sols.
Pierre-Alain Maron (INRAE) a apporté un éclairage scientifique sur l’écologie des sols et expliqué en quoi les diagnostics écologiques des sols sont indispensables à tout projet de renaturation des sols. Il a principalement axé sa présentation sur les micro-organismes du sol et leur implication dans de nombreuses fonctions écologiques pour le retour de la nature en ville ainsi que sur la façon de les mesurer. Il a rappelé les bases du diagnostic et précisé comment ces outils de recherche deviennent des indicateurs opérationnels, validés par la recherche académique. Le projet ProDij de la Métropole de Dijon a ensuite été présenté : il s’agit d’un projet dont l’objectif est de diagnostiquer de façon exhaustive la qualité physique, chimique et biologique des sols de l’aire urbaine de Dijon Métropole.
De son côté, Quentin Vincent (EODD) a axé son propos sur les diagnostics complémentaires aux précédents, à savoir les diagnostics sites et sols pollués (SSP) dont l’amiante, les diagnostics "zone humide" ainsi que les diagnostics agro-pédologique qui intègrent des diagnostics pédologiques (à travers l’ouverture de fosses pédologiques et de sondages), des diagnostics agronomiques basés sur des paramètres mesurés en laboratoire et des diagnostics biologiques (macro-faune, vers de terre, collemboles, …). Les coûts de ces diagnostics sont très variables en fonction des caractéristiques du site (hétérogénéité, des sols, niveau de contamination) et des techniques utilisées de 50 €/m² à 800€/m².
Suite aux questions du public, il a été précisé que les espaces privés n’ont pas été suivis dans le cadre du projet PRODIJ à Dijon, ils sont effectivement peu accessibles, par contre le projet VILLEGARDEN démarre en 2025 sur ces espaces en particulier afin d’acquérir de la donnée supplémentaire sur la qualité des sols en milieu urbain.
Enfin, pour clore cette troisième séquence, Florence Baptist (Soltis Environnement) et Philippe Baron (Métropole de Lyon) ont présenté un projet de renaturation à Saint-Priest (69), celui de la ZAC Berliet sur le territoire du Grand Lyon. Les étapes du projet ont été présentées, mettant en avant la complémentarité entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage à travers les diagnostics agro-pédologiques réalisés, la valorisation des ressources in situ et la recherche de gisements à proximité, les différents itinéraires techniques pour des intérêts agronomiques distincts selon les zones, la rédaction du DCE pour la production de terre fertile par la métropole du Grand Lyon, la mise en œuvre des terres fertiles et la renaturation des espaces ainsi que le suivi de la re-fonctionnalisation des sols. La pérennisation des aménagements a également été abordée à travers les modalités de gestion, les outils juridiques de protection ainsi que les suivis faune, flore et sol prévus sur ce site.
En complément, il a été précisé que par rapport aux questions sur la pollution, il est conseillé de se référer à la réglementation sur les sites et sols pollués qui oriente les démarches. Retirer tout ce qui est pollution concentrée / pollution non-concentrée est à regarder au cas par cas au regard des usages projetés et du risque sanitaire. La phytotechnologie n’est en général pas compatible avec la temporalité des projets mais a plus un rôle sur la (re)fonctionnalisation des sols avec un suivi lourd nécessaire sur le long terme.
Enfin, la quatrième dernière séquence de la journée s’est déroulée sous forme de table ronde autour des intervenants de l’après-midi, animée par Philippe Branchu.
1/ La première question posée portait sur l’évolution des projets de renaturation depuis la dernière journée technique en 2019 : est-ce que les approches ont évolué vers une meilleure prise en compte des sols, du point de vue opérationnel ou reste-t-on sur de l’innovation ?
- Les approches ont évolué mais il reste encore de la sensibilisation et de la pédagogie à réaliser : aujourd’hui la plupart des projets qui se revendiquent comme de la renaturation sont, dans les faits, une "simple" végétalisation.
- Est-ce que cela peut s’expliquer par un défaut de structuration de la profession et/ou un manque de sensibilisation des services techniques pour rédiger des CCTP ? a priori pas forcément, la pédologie est enseignée dans plusieurs cursus, notamment en écologie, cela peut être intéressant d’avoir des professionnels "multidisciplinaires".

2/ Pour continuer, une question portait sur l’existence ou pas de verrous scientifiques quant aux indicateurs, à leur maturité, leur opérationnalité dans les différents projets de renaturation ?
Depuis quelques années, des avancées en matière d’indicateurs notamment biologiques ont été observées. Cependant, les référentiels, notamment en milieu urbain, sont encore en cours de construction et nécessitent encore une homogénéisation au niveau national pour être plus opérationnel.
3/ Enfin, une question portait sur l’implication des citoyens ainsi que sur la notion de trame brune qui a également été abordée à travers ses grands principes et des actions à entreprendre pour leur reconstitution et leur préservation ?
Les trames existantes peuvent servir de base mais sont à adapter aux organismes auxquels nous nous intéressons (ex : vers de terre).
4/ Enfin des questions dans le public ont été posées, notamment sur le lien entre biodéchets et renaturation des sols ?
Il a été rappelé que la renaturation des sols ne signifie pas systématiquement un accroissement de la fertilité des sols, au contraire certains milieux sont naturellement pauvres avec une biodiversité très forte, inféodée à des milieux oligotrophes : à analyser au cas par cas.


