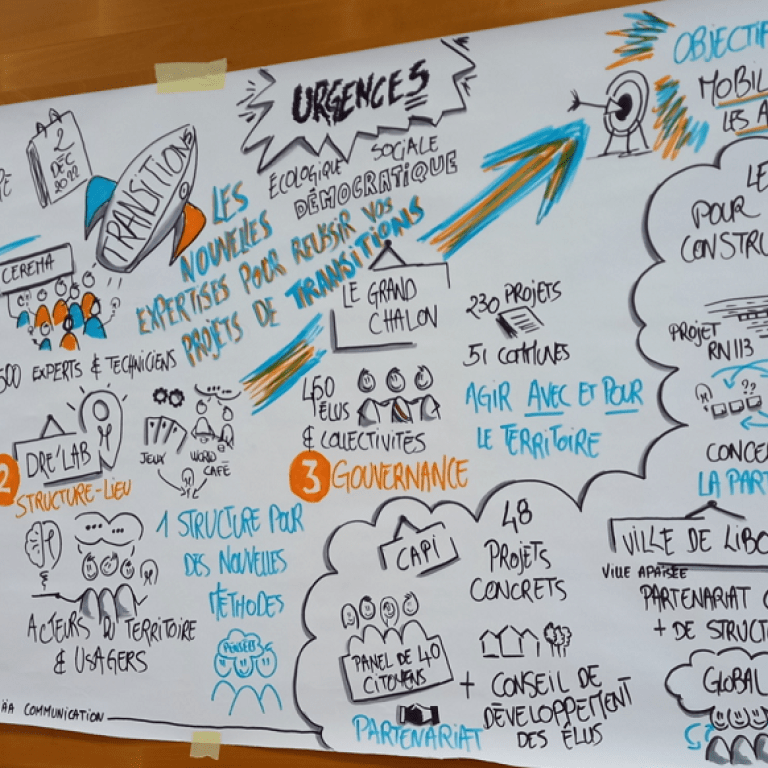Le croisement des savoirs et des points de vue "non experts" peut-il réellement enrichir la compréhension des phénomènes et contribuer à améliorer leur gestion ? Et si oui, comment, à quelles conditions ?
C’est cette question que le pôle participation du Cerema a posée à Emmanuel Martinais (ENTPE/EVS-RIVES), Laurent Jammes (CNRS/INSU), Céline Perherin et Marine Huet (Cerema), en animant un temps d’échanges dans le cadre des 7èmes Rencontres européennes de la Participation à Rouen.

Une synthèse de La table ronde
On entend parfois que le sujet serait trop technique, trop complexe, avec trop d’incertitudes… Comment expliquer la place encore restreinte accordée aux citoyens et parties prenantes dans les projets de prévention et de gestion des risques ?
Emmanuel Martinais : Le risque est une notion calculatoire, et la prévention des risques reste marquée par une très forte légitimité de l’expertise technique, notamment en ce qui concerne la caractérisation des phénomènes, des aléas – et ce malgré les critiques ou la défiance dont l’expertise peut faire l’objet par ailleurs. L’expert reste celui qui va permettre de bien décider et de se prémunir des contestations possibles, au motif qu’il mobilise la science et les techniques, dont on pense qu’elles permettent de produire les images les plus fiables des aléas en présence.
En conséquence, on a du mal à faire de la place aux autres formes de savoirs non techniques, voire à reconnaître l’intérêt de se confronter à ces autres formes de savoirs – savoirs "profanes", savoirs d’usages, d’expériences. Les citoyens, les riverains, les habitants ne sont pas considérés comme des acteurs à part entière, et la participation continue de faire l’objet de stratégies d’économie ou d’évitement, même lorsqu’elle est rendue obligatoire par la réglementation. L’exemple du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) illustre bien cette difficulté.

En quoi l’association des citoyens et parties prenantes permet-elle d’améliorer les démarches de gestion et de prévention des risques ? Quelle est la plus-value de la prise en compte des savoirs d’expériences des habitants, de l’instauration d’un espace de dialogue entre experts et citoyens ?
Céline Perherin : Le champ des risques naturels est peut-être aujourd'hui plus propice aux expérimentations. Dans le cas du risque inondation, je peux prendre deux exemples, l’un plutôt en matière de diagnostic et l’autre sur les actions.
Quand on travaille sur les cartes d’aléas, on utilise un certain nombre d’outils techniques et de modélisation pour reproduire les inondations. Mais on ne peut pas travailler concrètement sur la mise en place de ces outils si on ne sait pas quels sont les points d’entrée de l’eau, à quel endroit les vagues vont franchir un cordon dunaire, etc. : or ce sont les riverains, les acteurs du terrain qui ont cette connaissance. C’est donc vraiment en ayant un travail collectif, en croisant modèle numérique et observation, qu’on pourra avoir quelque chose qui est le plus représentatif possible.
De plus, cet exercice est aussi un processus : chacun va enrichir l’autre de ses propres savoirs et faire évoluer ses propres représentations. Cela permet d’avoir aussi des éléments de compréhension de ce qui est dans la mémoire collective, des évènements vécus, et de mieux adapter la communication : car si on envoie des messages en inadéquation avec les représentations que se font les gens de ce à quoi ils sont exposés, on ne réussira pas à faire passer l’information.


Marine Huet : En ce qui concerne le projet sur les glissements lents dans les Alpes, le point de départ ce sont des expertises "classiques" des géologues et géotechniciens du Cerema sur une route nationale, la route Napoléon, qui est régulièrement déformée sous l’effet de ces glissements. On a souhaité créer les conditions d’un échange entre les savoirs scientifiques des experts et les savoirs d’expérience des habitants, en partant du principe que la mémoire locale pouvait être intéressante pour mieux connaître l’évolution de ces glissements dans le temps. Et l’objectif était justement de questionner ce que cela produisait de mettre autour de la table à la fois des experts techniques, des habitants, des élus, et l’ensemble des gestionnaires du risque.
Pour les géologues, cela a permis une prise de conscience de la distance de l’expertise avec la société civile et de se rendre compte que les habitants, voire certains élus, étaient totalement démunis face à ce risque. Le glissement impacte la route nationale mais aussi des maisons qui sont à quelques centaines de mètres, qui se fissurent, sans que les habitants sachent quoi faire et quel est le danger. Cela a permis aussi aux experts de travailler dans une relation de confiance, car ils sont parfois exposés, notamment en gestion de crise, à des conflits très difficiles avec les populations et les acteurs locaux.
Là, grâce au cadre proposé, on a pu établir une relation qui permettait de partager librement les apports et les limites des démarches instrumentales, de parler de l’incertitude scientifique aussi avec les habitants – ce qui suppose pour les experts un important travail d’amélioration de la transmission des connaissances. Enfin, cela a eu un impact positif sur la production scientifique puisque cela a permis un élargissement spatial et temporel de l’analyse : les préconisations pour l’action se sont enrichies d’autres éléments, comme les pratiques agricoles, et l’expertise technique a pu s’inscrire dans le temps en s’appuyant sur la mémoire des habitants.
Pour les élus et les habitants, ce qu’on observe c’est une autonomisation des acteurs locaux, même si elle n’a pas été totalement aboutie dans ce projet. Cela leur a apporté une meilleure perception du phénomène géologique, et une compréhension aussi des limites techniques d’intervention actuelles. Il y a eu aussi pour certains une forme de gratification de pouvoir être acculturés aux méthodes et aux démarches scientifiques. Et puis surtout cela a permis aux acteurs locaux de trouver les ressources pour se mobiliser, d’accélérer la mobilisation et l’amplifier, soit individuellement, soit collectivement. Ce qu’on observe de manière globale, c’est que les différents types de connaissances scientifiques ou les savoirs d’expériences sont in fine très complémentaires.
Laurent Jammes : En ce qui concerne le sujet un peu particulier de l’exploitation du sous-sol, pour des projets en lien avec la transition énergétique (géothermie, stockage d’hydrogène, de CO2, prospection minière…), les enjeux de la participation sont multiples. On a des opérations extrêmement complexes et en fait relativement incertaines, qu’il est très difficile d’analyser avec une casquette d’ingénieur.
Dans l’industrie on veut toujours tendre vers une approche quantitative des risques et on raisonne en termes de criticité, c’est-à-dire le produit de la probabilité d’un risque et de la sévérité de l’impact. Ce calcul doit permettre une analyse coût bénéfice pour définir les actions à mettre en œuvre. Mais cela repose sur des hypothèses, des modèles qui ne sont pas du tout exempts de défauts.

C’est aussi une question de justice sociale, car les actions à prendre vont présenter des bénéfices pour certains, des inconvénients pour d’autres, il y a donc un moment nécessaire de négociation pour ces actions de mitigation, qu’elles soient préventives ou correctives. Sur un autre plan, les citoyens peuvent aussi prendre une part active dans des actions de suivi des risques, de ce qu’on appelle le monitoring. Cela permet une appropriation de la question technique, et donc une familiarisation qui permet de réduire le niveau de crainte et de peur un peu subjective qu’il peut y avoir au regard de sujets très techniques.
Pouvez-vous identifier, à partir de vos expériences ou observations respectives, des pistes d’amélioration, ou des conditions à mettre en place pour favoriser le dialogue experts-citoyens et pour que ces échanges profitent aux actions de prévention et de gestion ?

Céline Perherin : Pour le projet BRIC, on a beaucoup appris de nos collègues anglo-saxons. Aujourd’hui ils ne font plus de campagne nationale d’information, dont l’impact apparaît quasi nul, et privilégient l’émergence et le soutien d’initiatives locales comme les "Flood Action Groups". Ce sont des communautés de bénévoles qui s’organisent, et ce qu’on observe c’est que ce n’est pas seulement l’inondation qui les rassemble mais tout autant le lien social – le plaisir de se retrouver le week-end, d’aller faire du défrichage, d’aller planter des haies, prendre un goûter, discuter.
Et à cette occasion il y a un certain nombre de messages qui passent, ce qui permet aux gens de trouver plus facilement du soutien en cas d’inondation. Les anglo-saxons privilégient ce type d’approches et cherchent à faciliter la discussion entre ce type de groupe et les autorités locales – en sortant d’une approche purement descendante.
Pour améliorer ce dialogue entre experts et citoyens il est intéressant aussi de sortir des démarches purement contraignantes pour se permettre d’avantage d’expérimentation, en cherchant par exemple à aller plus loin dans l’association des citoyens au processus de décision. On peut citer l’exemple de certaines démarches portées par des collectivités, comme dans le cadre de l’appel à partenaires Gestion intégrée du littoral et du partenariat mis en place entre la communauté d’agglomération la CARENE, autour de Saint-Nazaire, et le Cerema.
Dans ce contexte, les élus ont instauré un comité de pilotage et, en parallèle, un groupe miroir de citoyens, un peu sur le modèle des conventions citoyennes. Ce groupe de citoyens a à sa disposition les mêmes éléments que le comité de pilotage, et peut venir questionner le comité de pilotage ou apporter des éléments supplémentaires. On est là davantage dans une notion d’expertise comme processus collectif, dans une posture d’accompagnement du processus de décision.
Marine Huet : En ce qui concerne le projet MLA3, on a identifié trois éléments qui nous semblent avoir été importants dans la réussite de la démarche.
C’est tout d’abord la préparation des échanges en amont, avec chaque acteur, pour intéresser les personnes à la démarche, pour identifier les enjeux et difficultés de chacun et commencer à travailler pour faire évoluer les postures. Un public se "construit". Cette préparation est chronophage mais elle est essentielle pour légitimer les habitants dans l’expression de leurs savoirs et points de vue, pour valoriser leurs connaissances et les aider à la réinvestir dans les ateliers participatifs, ou pour éviter les postures potentiellement inhibantes de certains gestionnaires. Il faut prêter attention aussi à la façon de construire les temps de rencontre, de prise de parole et favoriser les moments informels pour faciliter la relation de confiance.

Le deuxième point porte sur les modalités d’animation de la démarche. Dans ce projet on s’est appuyé sur l’équipe en sciences sociales, avec un rôle de facilitation ou d’animation, mais la formation des experts est nécessaire aussi pour qu’ils soient de plus en plus en mesure d’intégrer ce type d’approche dans leur mission. Cette animation s’appuie sur le travail préparatoire pour permettre de bien expliciter les enjeux et de gérer la conflictualité – qui a toute place dans un espace de dialogue multi-acteurs – en permettant à chacun de trouver sa place, d’oser prendre la parole et défendre son point de vue.
Enfin, mais on touche là à la limite du projet, c’est la question des relais et de la disponibilité dans la durée des services de l’Etat et des élus locaux pour mobiliser les connaissances produites et mettre en œuvre les actions. Cela suppose de bien associer tout au long du projet les gestionnaires concernés, ici les gestionnaires des différents espaces impactés par le glissement, mais cela ne suffit pas.
Laurent Jammes : De mon point de vue, il faut replacer la question de la participation dans le schéma global des projets. La question de la participation citoyenne à la gestion de risque, notamment pour les projets d’exploitation et d’usage du sous-sol, n’est qu’une toute petite partie des enjeux. Les citoyens ont à se prononcer d’abord sur la qualité des projets : est-ce qu’ils correspondent vraiment à des feuilles de route qui ont l’accord de tous, co-construites au niveau des territoires ou au niveau national ?

Emmanuel Martinais : Ce que j’observe, notamment dans le domaine de la prévention des risques industriels, c’est que depuis deux ou trois décennies on bute collectivement sur les trois mêmes constats : une réelle attente de participation des riverains et habitants, surtout quand les décisions les concernent directement ; une action publique configurée pour rendre possible cette participation ; et au bout du compte, une association aux décisions extrêmement limitée de ces riverains et habitants, qui restent très peu présents dans les dispositifs censés les mettre à contribution, comme les commissions de suivi de sites.
Les explications avancées sont toujours les mêmes : des instruments ou dispositifs qui ne seraient pas suffisamment efficaces, des populations qu’on n’arrive pas à faire participer. L’idée persiste parfois que les habitants seraient non compétents, ou non rationnels, et qu’on "sait mieux" qu’eux. Et puis il y a aussi des attitudes de prudence, on craint de faire peur, de susciter des conflits inutiles.
On évoque également la question des asymétries de connaissance qui empêcheraient la discussion et nuiraient au dialogue. Mais ces craintes, légitimes, masquent des causes plus profondes liées à l’absence de moyens, le manque de valorisation, le déficit de formation en matière de participation au sein des services gestionnaires. Et on propose toujours les mêmes solutions : développer des instruments plus innovants, éduquer les populations par le biais de cette fameuse culture du risque. Mais cela ne fonctionne pas.